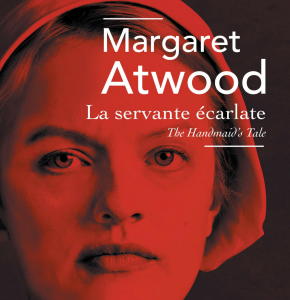Cette lecture est une suggestion de Madame Lit, dans le cadre de l’opération Le 12 août, j’achète un livre québécois.
En 1845, deux navires d’exploration britanniques, l’Erebus et le Terror, partent, sous le commandement de sir John Franklin, à la recherche du passage du Nord-Ouest, qui permettrait de passer de l’Atlantique au Pacifique en contournant le continent nord-américain par le nord. L’auteure nous entraîne, par son récit, dans cette expédition calamiteuse, en alternant, d’un court chapitre à l’autre, les points de vue et les personnages.

D’un côté, on suit par intervalles discontinus la progression de l’expédition, notamment à travers le regard de Francis Crozier, le capitaine du Terror, sans doute le membre le plus lucide et le plus compétent de cette aventure catastrophique. On partage ses états d’âme, sa singularité. Il ne partage pas la vision des choses stéréotypée des autres officiers. Il est parti dans cette expédition en partie par dépit amoureux : éconduit par Sophia Cracroft, la nièce de John Franklin, il fuit la source de son tourment pour retourner dans une solitude polaire au milieu de ses hommes.

De l’autre, on suit la vie sociale et les pérégrinations de Lady Jane, l’épouse de l’illustre John Franklin, toujours accompagnée de sa nièce, la fameuse Sophia. A travers ce récit parallèle, on a un aperçu de la vie au sein des classes aisées de l’époque victorienne, de ces mondanités que l’on retrouve en miroir au sein même de l’expédition, entre officiers. Lady Jane est un personnage étonnant, une femme passionnée par les grands explorateurs. Elle a épousé Franklin avant tout pour son statut d’explorateur, plus que pour l’homme, par ailleurs peu flamboyant. Elle voyage beaucoup, prend des notes sur tout ce qu’elle voit, est curieuse de tout. Une femme qui, en un autre temps, aurait fait sans doute une grande exploratrice, tant elle semble plus énergique passionnée et déterminée que son mari, dont le prestige semble outrepasser ses compétences réelles. Cette soif de découvertes, cette fascination pour les grands explorateurs m’ont renvoyé à une lecture récente « Zoonomia », dans laquelle la soif de découvertes s’exerce sur l’Afrique, à la même époque que l’expédition Franklin.
Un récit fluide, centré à la fois sur les personnages et sur le contexte social de l’époque, d’une expédition célèbre (bien que méconnue en France). Ayant fait connaissance de l’expédition Franklin à travers le « Terreur » de Dan Simmons (qui ajoute une dose de surnaturel à une aventure qui en soit est déjà terrifiante, et dans lequel Crozier est également un personnage de premier plan), j’ai lu avec intérêt cet autre regard porté, un roman (car cela reste malgré tout une œuvre de fiction) qui entre dans l’intimité de ses protagonistes et décortique sans parti pris les failles de la société dans laquelle, j’en ai le sentiment, une telle tragédie avait quelque chose d’inévitable.
Du blanc, à perte de vue. Le blanc du ciel qui se fond dans le blanc de la terre enfouie sous la neige, qui se fond dans le blanc de l’eau couverte de glace, qui se fond dans le blanc qu’on finit par avoir sous les paupières quand on ferme les yeux.
Un blanc gris sous les nuages lourds de neige, un blanc d’ombre qui avale les distances et trompe la prunelle. Un voile blanc qui recouvre tout.
Un blanc noir les jours d’hiver sans soleil.
Translucide et voilé, impénétrable, aqueux et solide, immaculé, envers de toutes les souillures. Un blanc comme un œil, qui tout à la fois masque et laisse transparaître ce qui se trouve derrière, dedans, deçà, delà.
Un blanc bleuté qui scintille doucement sous la lueur de la lune énorme, boursouflée, et sous la lumière des millions d’étoiles étincelant sur la neige où elles semblent reflétées ou bien tombées par terre.
Le blanc jaune des banquises où rampent les phoques et des champs de neige où l’on sort se soulager et vider les pots de chambre.
Le blanc cendré des nuits sans lune qui durent parfois des semaines.
Partout le blanc. Avec, de loin en loin, le crachat d’un marin, comme une étoile rouge dans la neige.
Perlerorneq. C’est le mot par lequel les Esquimaux nomment ce sentiment rongeant le cœur des hommes pendant l’hiver qui s’étire sans fin et où le soleil n’apparaît plus que de loin en loin. Perlerorneq. Rauque comme la plainte d’un animal qui sent la mort approcher.
Auteur : Dominique Fortier
Titre : Du bon usage des étoiles, 2008
Editions de La Table Ronde
ISBN : 9782710368359